BESTIAIRES FABULEUX
|
Les Berbères Le mot Berbères , emprunté par le français à l'arabe et par ce dernier au latin, a perdu très tôt son sens primitif d'"étranger à la civilisation gréco-romaine". Il désigne aujourd'hui stricto sensu un groupe linguistique nord-africain: les berbérophones, ensemble de tribus qui ont parlé ou parlent encore des dialectes apparentés à un fonds commun, la "langue" berbère. Dans l'usage courant, qui continue la tradition arabe, on appelle Berbères l'ensemble des populations du Maghreb. Toutefois, l'usage devient fautif, lorsqu'il parle de race berbère. Il n'existe pas en effet de race berbère, les berbérophones présentant des types ethniques bien divers. L'observation la plus simple permet d'opposer un type kabyle, un type mzabite et un type targui, que la vieille enquête de Bertholon et Chantre (1913) avait reconnus comme des groupes spécifiques à côté de groupes divers. Les Berbères ne sont donc pas définissables par des critères raciaux. Les premières influences historiquement attestées furent celle des Phéniciens et, par leur intermédiaire, celle des Grecs: elles ne paraissent pas avoir beaucoup marqué les Berbères. La longue domination romaine, puis byzantine, ne fut pas beaucoup plus efficace. Elle ne s'étendit jamais à toutes les populations berbères et les tribus soumises s'insurgèrent souvent. La civilisation romaine n'assimila et ne christianisa qu'une très faible partie des Maghrébins: même les convertis recoururent aux schismes pour affirmer leur indépendance. Le Maghreb resta farouchement lui-même. La langue berbère représente, en Afrique du Nord et jusqu'au-delà du Sahara, le seul lien d'une communauté de plus de douze millions d'hommes. Mais c'est une communauté qui s'ignore parce que les groupes fort divers qui la composent sont dispersés sur d'immenses territoires. Partout minoritaire, le berbère n'est la langue officielle d'aucun État. Malgré quelques tentatives limitées, il n'a jamais accédé au rang de langue écrite. Pour aborder sans préjugés la littérature des Berbères, les meilleurs guides seraient les journaux de route du siècle dernier ou de ce début de siècle. Un regard naïf sur une fête berbère, des chœurs dansant sur la montagne préparent mieux à recevoir le message d'un poème berbère qu'une analyse sévère. Les Nord Africains berbérophones forment aujourd'hui un ensemble de tribus dispersées, habitant principalement l'Afrique du Nord. Tout au long de leur histoire, ils n'ont pas manifesté la volonté ou le désir de former une unité et ils ont soit vécu en anarchie tribale soit été rattachés à des royaumes ou empires. La domination romaine n'a pratiquement pas laissé de traces sur leur civilisation, civilisation d'ailleurs négligeable du point de vue littéraire et artistique. Il n'en va pas du tout de même pour les invasions arabo-musulmanes des VIIe et XIe siècles. La majorité des Berbères, nomades ou sédentaires, a été arabisée, se tient pour arabes et a tourné le dos à ses origines sans pour autant avoir particulièrement brillé parmi les représentants de la civilisation à laquelle ils se sont rattachés. Depuis 13 siècles, l'avenir des Berbères se reflète dans les institutions musulmanes et la langue arabe mais elle est restée en marge de l'Histoire. La permanence des civilisations archaïques fait que ni complètement africaine ni entièrement méditerranéenne, tantôt subjuguée par l'Orient, tantôt rattachée à l'Occident, la Berbérie balança au cours des siècles à la recherche de son destin. Comme disait le doyen BALOUT : " au point de départ, les berbères auraient pu avoir un destin "Européen" mais ils en furent empêchés deux fois : d'abord par Carthage, puis surtout par l'Islam". Rachida Rougi. |
Bestiaires Fabuleux
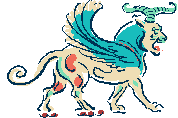 Si nous voulions considérer que les animaux appartiennent, selon leurs caractères, à l'eau, au feu, à la terre ou à l'air, nous pourrions nous pencher sur la présence d'une de ces catégories dans notre île, que ce soit dans les "fole", récits merveilleux ou fantastiques, ou dans l'art, plus particulièrement Roman. Nous avons choisi de vous entretenir ici des "bêtes", existant ou ayant existé ou imaginaires, qui semblent sortir des entrailles de la Terre, des sous-sols, des ténèbres ; rampants, jugés souvent répugnants, associés au Mal, aux abîmes, à l'enfer, ils sont nombreux à nous intriguer. Ce sont le serpent, le basilic, le "magu à sette teste"(ou dragon) , l' hydre, la vouivre, et quelquefois encore, la Sirène, mi femme, mi poisson, qui perd les hommes. Le serpent est perçu de façon ambiguë selon les civilisations, et, en Corse, selon tout simplement les pieve et les époques. Les Egyptiens et bien d'autres l'ont sacralisé ; loin de nous, certains l'apprécient tant qu'ils le mangent, d'autres en font leur animal de compagnie, (il paraît que la Corse n'échappe pas à cette mode). Nous tenterons cependant de le définir tel qu'il est représenté dans l'île. Parmi ses avatars , nous choisissons de le révéler sous deux aspects : l'un respectant son anatomie, l'autre l'affublant d'un visage féminin, dénommé alors vouivre, ou Biscia. Comme dans les manuels de sciences naturelles et tel qu'on le voit dans nos campagnes. Un rapide inventaire du fonds insulaire le désigne comme l'animal le plus présent sur les frontons et modillons de nos édifices religieux. A l'intérieur de nos églises et de nos chapelles, certes, il est au pied de la Vierge, qui le foule aux pieds (Voir Eglise de la Conception, Rue Napoléon, à Bastia).Il est le tentateur, celui qui a causé la perte d' Adam et Eve ; il est l'envoyé et l'agent du Malin, celui qui corrompt. A l'extérieur, sur les façades, gravé et sculpté sur des modillons, -certaines thèses suggèrent que gargouilles ou autres représentations du Mal, comme à Notre Dame de Paris, étaient fixées au dessus des portes par conjuration et pour montrer au croyant à quoi il échappait-, il rappelle les horreurs qu'il a apportées à l'humanité. Mais on le connaît et on le détruit. Ainsi à San Quilicu, il est mis à mal par un personnage en robe, armé, qui s'apprête à le tuer. A Saint Michel de Muratu, nous le retrouvons en passe d'être étêté car en face de lui, il y a encore un valeureux combattant. On le détestait parfois tant que dans bien des communes, on craignait de le toucher par mégarde ; même en plâtre peint, au pied d'un personnage saint, il gênait l'avancée de certains fidèles dans l'église .C'était "u serpacciu". Imaginaire, la vouivre : Décrit dans les fole ou sculpté sur certains modillons, cet animal monstrueux, proche de la vipère mais à visage de femme, sait nager avec aisance, ayant une prédilection pour les rivières et les étangs, donc pour l'eau douce. La créature aime se glisser sous les roches, dans les anfractuosités où elle disparaît. Près de Sartène, à Olmiccia, elle évoluait à l'endroit du lit d'une rivière, U Rizzanese, dit u tufone à e fate (le trou aux fées). Un jeune homme, Poli, intrigué par le son de feuilles froissées qu'elle produisait, la vit et en tomba amoureux. Il l'épousa ; malheureusement, le couple ne pouvait durer du fait de la monstruosité de l'épouse et ils se séparèrent de façon dramatique. En Balagne, une bête meurtrière, également désignée sous le terme de a biscia, serpent mais cette fois à tête d'oiseau, désolait la région, réclamant sans cesse un plus odieux tribut. Même sifflement caractéristique, même goût pour l'eau (ici le marais de la Cannuta)...mais moins de charme et davantage de cruauté. Fort heureusement, le Seigneur de San Colombanu délivra l'endroit de son monstre, dont le sang, dit-on, était empoisonné. L'ancienne église Santa Maria Assunta, près du pont de l'Ostriconi, comporte sur un linteau une représentation de cette biscia (cf. Guide de la Corse mystérieuse, édition Tchou) Il nous faudrait encore bien des pages pour vous montrer la richesse de ce sujet et vous faire entrevoir les difficultés que pose une telle recherche ; si cela vous intéresse, si vous avez entendu ou vu un signe de la présence d'animal fabuleux, ne le négligez pas. M.-F. B-C |